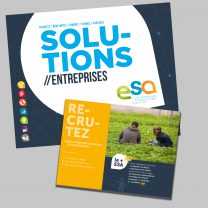Biographie
Élève brillante des Sœurs de La POMMERAYE, elle refuse cependant, par choix conscient d’attachement familial, de poursuivre ses études ; démarche couramment proposée à l’époque pour les « sujets prometteurs »! Ceci d’autant plus que le départ du frère aîné au service militaire puis à la guerre, en 39 -il n’en reviendra qu’en fin 44-, prive la ferme d’une énergie vitale. Comme beaucoup de jeunes femmes des Mauges à l’époque, elle se consacrera donc pendant cette période aux travaux des champs et de l’élevage à la belle saison et à des travaux de broderie à domicile sur commande d’industriels choletais du textile, à la mauvaise saison.
Marquée par les personnalités de ses grands-pères, riches d’engagement public et de qualités d’animateur, elle saisit l’opportunité de développement personnel et social que lui propose la JACF. Elle y milite avec ardeur jusqu’à ses 22 ans.
Au sortir de la guerre, son curé lui propose de rejoindre à Paris, un groupe de femmes qui s’attache alors au développement du syndicalisme féminin (défense des « petites mains » de la haute couture) dans le cadre de la paroisse Notre-Dame du Travail, non loin de la gare Montparnasse.
Ce sera bientôt l’Institut Notre-Dame-du-Travail -laïques consacrées, immergées dans la cité pour une évangélisation spécifique-, reconnu par Rome, auquel Madeleine MANCEAU consacrera toute sa vie et dont elle sera plus tard, dans la plus totale discrétion et à l’insu de la plupart des gens qui la côtoyaient, à des niveaux divers, une des responsables majeures ; de plus elle sera nommée consulteur à Rome après le Concile Vatican II.
Travaillant auprès de ces femmes, elle consolide son potentiel en suivant : les cours supérieurs du CERCA, les enseignements des Jésuites de la rue de Sèvres sur la doctrine sociale de l’Église, … et participe à la fondation avec le Père FOREAU d’une section jaciste dédiée aux étudiants issus du monde paysan : l’A.R.E.C.. Elle prépare en outre le diplôme d’infirmière (1950), puis le diplôme d’assistante sociale (1952).
Avec ce bagage -elle a alors 29 ans-, elle revient en terres natales et prend la responsabilité administrative du Centre Féminin d’Enseignement Agricole du Pré Neuf à ETRICHE – M et L – (actuel Lycée Technique privé E. Michel et pendant de l’IREO -masculin- de Chatillon à Cantenay-Epinard) et y achève sa spécialisation « rurale » d’assistante sociale dans le cadre de l’École Normale Sociale d’Angers.
A l’automne 1954, elle rejoint le CERCA – dont les Pères jésuites avaient confié la direction, en 1945, à Victor ROYER, instituteur remarquable-, pour y relever une de ses amies (Marie MALINGE) sur la suggestion de celle-ci ; laquelle avait succédé à Madame Weil, trois ans auparavant. Mme WEIL, au début des années 30, avait été chargée par les Jésuites de développer les enseignements féminins au CERCA.
Telles sont donc les racines qui ancrent Madeleine MANCEAU au monde paysan et rural angevin, dans une démarche de « promotion sociale » et telle est la source profonde de ce que fut son engagement professionnel au service de la « promotion sociale » du monde agricole et rural.
L’impression dominante lorsqu’elle arrive au CERCA, est celle d’une institution déclinante, qui va vers sa caducité … et cependant, une institution à la remarquable capacité d’innovation et d’invention. Témoin par exemple et à l’époque, les émissions matinales (à l’heure de la traite) sur Radio Luxembourg de « Jean-Pierre CERCA », pour laquelle entre autres, l’équipe des enseignements féminins produisait régulièrement des rubriques … ! Témoin également, l’ouverture sous l’impulsion du Père de LAULANIE, d’une filière conduisant à l’examen du B.E.P.C. ; prémices du développement à venir (1962) de l’Institut de Promotion Agricole de l’Ouest et du Centre Féminin de Promotion Agricole qui verront le jour après le Centre de Formation de Techniciens de la Vulgarisation (1960) dans le cadre des mesures voulues par le gouvernement de l’époque (E. PISANI, ministre de l’Agriculture) pour la mutation des populations agricoles et rurales. Témoin aussi la mutation des séquences de regroupement locales des élèves de l’enseignement à distance, par la mise en place des sessions de regroupement, justement dans les locaux du Pré-Neuf dans un premier temps. Etc … .
Forte de son expérience, Madeleine MANCEAU est chargée d’ouvrir le C.F.P.A. en 1962, d’abord dans les locaux peu adaptés de l’ancienne résidence des jésuites du 78, Rue du Quinconce à Angers. Puis, dans ceux d’un centre de loisirs d’été de la ville d’Angers en Port-THIBAULT, à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Ce centre de formation professionnel était dédié aux femmes d’origines agricoles et rurales en vue de fournir une aptitude reconnue en secrétariat et comptabilité, entres autres, à celles qui souhaitaient soit trouver en emploi au pays, soit migrer en milieu urbain.
En 1972, le C.F.P.A., avec les autres Centres de Promotion sociale générés par le S.E.A.R.A. (C.F.T.V, I.P.A.O.), est installé dans l’ancien couvent des Dominicains, nouvellement acheté pour ce faire, au 44 de la rue Rabelais ; emplacement actuel de la Fac de Sciences de l’Université Catholique.
Concomitamment, en 1964 -l’ESA vient de prendre possession de ses nouveaux locaux au 27 de la rue Fonteneau-, le C.E.R.C.A avait quitté les anciennes dépendances -en fait les anciennes écuries!- de la propriété bourgeoise de « La Fontaine », au long du bas de la rue Rabelais -aujourd’hui disparus-, pour être installé dans les locaux de l’École historique (1923). (Les « sessionnaires » du C.E.R.C.A puis l’internat du C.F.P.A y furent installés pour quelques temps.).
Au départ en retraite de M. ROYER (1969), Louis PILARD assure la direction du CERCA – où François LEMIEGRE venait de développer les premières formations BTS à distance-. A l’été 71, au départ de L. PILARD, Madeleine MANCEAU est chargée de la responsabilité du C.E.R.C.A., conservant en la déléguant, celle du C.F.P.A., puis prenant en charge, en plus, le C.F.A national « Elevage de Petits animaux » (1974), dérivé du savoir-faire du C.E.R.C.A..
En 84, au départ de Guy EMERARD, -DG du S.E.A.R.A. de 76 à 84-, elle fait partie du Directoire installé par le Pdt ALISON. Elle est en charge de la direction et de la coordination de l’ensemble des Centres de Promotion Sociale du S.E.A.R.A (C.F.T.V – C.F.P.A. – I.P.A.O.), du C.E.R.C.A. et du C.F.A. et de celle de l’E.S.F.A., en pleine mutation vers AGRICADRE.
Dès la fin des années 70, Madeleine MANCEAU est installée au 44 de la rue Rabelais. Appuyée par la Direction Générale, elle s’entoure d’une équipe solide de jeunes cadres (Luc ALBERT, Yves CAPY, Odile GINESTET, Gilles LALUQUE, Bruno SALMON-LEGAGNEUR, …) qui prendront une part essentielle dans le développement de ce qui va être nommé « Groupe ESA » à partir de 1987 sous la direction générale d’Aymard HONORE.
Clairvoyante et pugnace, à l’écoute des réalités du « terrain », attentive aux orientations législatives ou réglementaires, elle entraine les équipes avec élégance, par touches successives, permettant à chacun d’exprimer le meilleur de ses dons au profit des personnes qui faisaient confiance à l’institution
Elle prend sa retraite début 1987.
Pour les équipes du « 44 » qui rejoignent alors l’ESA et son infrastructure (laboratoires pédagogiques et de recherches, médiathèque, moyens des technologies de l’information) dans les nouveaux bâtiments du 55 rue Rabelais, c’est une mutation majeure.
En effet, l’accent mis de longue date -notamment par Madeleine MANCEAU- sur l’apprentissage va voir une montée puissance et en gamme considérable (B.T.S puis licence Pro et Ingénieurs) dans les années suivantes. (Près de 340 diplômés en 2017 – Plus de 650 apprentis inscrits en 2018).
Mais, en même temps, ce qui avait fait l’essentiel de la mission de Madeleine MANCEAU avec sa plus entière dévotion, la « promotion sociale » du monde agricole et rural, par les voies diverses de la formation à distance, de l’apprentissage, de la formation continue … ont été supplantées (évolutions sociétales, législations, « marchés » … obligent …), pour l’essentiel, par les formations dites « initiales » … !
Ce savoir-faire accumulé a fourni le socle d’un nouveau départ de l’Ecole Supérieure d’Agricultures –qui situe l’Apprenant au centre du dispositif– vers une formation tout au long de la vie…